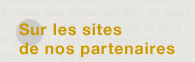La démocratie-monde
En Amérique latine, en Afrique, en Asie, on m’interroge sur l’avenir de l’Europe. Avant, je répondais avec assurance, avec la conviction des maîtres d’œuvre inspirés par la perspective de l’ouvrage qui s’édifie. Mais depuis quelque temps, je suis moins sûr. Le vent a tourné et je vois s’amonceler des nuages qui pourraient annoncer l’orage. Le projet européen n’a pourtant jamais été aussi pertinent. Pour les Européens eux-mêmes, mais aussi pour le reste du monde. Car ce qui s’y invente depuis plus de cinquante ans, c’est aussi ce dont le monde a tant besoin aujourd’hui : un pouvoir démocratique à la hauteur des enjeux gigantesques auxquels nos sociétés sont confrontées et que les États seuls ne peuvent plus porter. C’est fort de cette expérience européenne, avec ses succès et ses échecs, qu’il nous faut partir aujourd’hui - j’en ai la conviction - à la recherche d’une nouvelle gouvernance mondiale, capable de conjuguer l’efficacité que les États n’ont plus et la légitimité que les organisations internatio-nales n’ont pas encore. Cette nouvelle gouvernance, c’est ce que j’appelle la démocratie alternationale.
La planète ne va pas bien. La construction européenne piétine. Nos démocraties s’alanguissent. Je crois que le moment est venu de penser politiquement la réalité nouvelle qui a fait irruption au XXe siècle, une réalité qui enserre nos existences comme un tout. Cette réalité, c’est le monde.
Le monde n’est plus le « dehors » de notre vie domestique : il a fait effraction dans le quotidien de nos vies, il y a introduit de nouveaux risques, de nouvelles formes de concurrence, de nouveaux défis, de nouvelles peurs. Les arrangements sociaux et politiques de nos sociétés en ont été bousculés. Il nous a placés devant un défi que le XXIe siècle aura à charge de relever : inventer une vie politique mondiale, à la fois démocratique et à la hauteur d’enjeux qui sont désormais d’envergure planétaire. Inventer parce que, aujourd’hui encore, l’action collective ne semble pouvoir puiser sa légitimité que du sein des démocraties représentatives nationales.
Comment cette grande transformation a-t-elle eu lieu ? Par un triple basculement, décisif pour l’humanité entière et dans lequel la construction européenne a trouvé l’énergie de sa naissance.
Le premier trouve son origine dans la guerre. De 1914 à 1945, le monde a vacillé, déchiré par les soubresauts de la vieille Europe, ses passions nationalistes et ses aventures totalitaires. À Verdun d’abord, puis à Auschwitz, nous avons pris conscience, selon le mot de Valéry, que nos civilisations étaient mortelles2. Pour les pères de la nouvelle Europe, l’échec de la Société des nations (SDN), première ébauche de prise en charge commune de l’ordre international, et les ravages des deux conflits portés au cœur du continent et du monde ont résonné comme un fracas fondateur dont la leçon s’est imposée avec la force d’une évidence : une paix enfin durable ne pouvait être fondée que sur l’union des peuples européens.
Le deuxième basculement est celui qui a accompagné, à la fin du XXe siècle, la chute du Mur de Berlin, l’effondrement de l’empire soviétique et le développement de nouvelles instabilités géopolitiques. Il met en lumière les limites de l’action à l’échelle nationale face aux nouvelles réalités mondiales. Il rend aussi plus explicite le projet tacite de la construction européenne : se donner les moyens d’agir au-delà de ses frontières. De la même manière, dans le reste du monde, ce basculement a souligné la nécessité de régulations et de prises en charge collectives des questions globales. Certes, des puissances comme les États-Unis peuvent se permettre de persévérer dans une logique unilatérale, au besoin en recourant à la force armée. Mais cette logique n’aura qu’un temps. Elle ne pourra effacer le fait politique majeur du siècle qui s’ouvre : désormais, les problèmes du monde nous concernent tous, et il n’y a plus de sanctuaire. Le caractère global d’un nombre croissant de phénomènes - la raréfaction des ressources énergétiques, la destruction de la biosphère, la diffusion des pandémies, la volatilité des marchés financiers, les mouvements migratoires provoqués par l’insécurité, la pauvreté ou les instabilités politiques systémiques - est le fruit du troisième basculement : la mondialisation. La mondialisation, que j’entends comme l’interdépendance croissante de tous les peuples de la planète, la mise en relation du lointain et du prochain, touche aujourd’hui l’ensemble des dimensions de la vie des sociétés et non leur seule dimension économique. C’est déjà une réalité et c’est encore un processus en marche. Nous vivons une expérience historique inédite malgré les formes de proto-mondialisation qui ont existé par le passé3. Il ne faut donc pas comprendre la mondialisation comme le seul jeu de l’inflation du marché4, mais comme l’accélération et l’approfondissement d’une dynamique beaucoup plus globale qui trouve son origine dans le développement pluriséculaire du capitalisme de marché. Cette dynamique a atteint aujourd’hui un stade d’expansion inédit, à la fois géographiquement et par ses ramifications sociales. Elle s’étend à toutes les sociétés humaines et développe à l’échelle de la planète ses logiques de croissance et d’innovation en même temps que de dégradation sociale, culturelle, environnementale ou politique. C’est cette force, véritable lame de fond de l’histoire, qui façonne et travaille notre monde. Et face à ces enjeux globaux, surgit une nouvelle exigence d’efficacité que ne peuvent plus satisfaire seuls les États-nations. La nécessité se fait jour, dans les conflits et dans les crises mondiales, dans ce que révèlent les mobilisations politiques, mais aussi au travers des crises qui semblent frapper les pouvoirs démocratiques de la planète, d’imaginer des formes de pouvoir autres, capables de répondre à ces nouveaux enjeux.
L’Europe est pleinement concernée. En 1945, elle était arrivée au bout de son modèle géopolitique. Son échec se mesurait à l’aune de la violence destructrice qui s’était abattue sur elle. Héritière de très longs processus, de nombreuses conceptualisations, de diverses actualisations au cours de l’histoire - projets de gouvernement universel, échafaudages cosmopolitiques... -, la nouvelle Europe devait pourtant inventer autre chose. Il lui fallait inventer la paix, c’est-à-dire s’armer d’une nouvelle utopie.
Pour les pères du projet européen, c’est la prospérité partagée qui devait offrir son assise concrète à cette ambition : ce fut la première incarnation de l’Europe, la Communauté économique du charbon et de l’acier (CECA). Pour eux, la mise en commun de ces deux piliers de l’économie européenne de l’époque, éléments de souveraineté nationale forts, aurait sans doute la force d’éloigner le spectre de l’impuissance qui avait décimé la SDN. Ce faisant, l’Europe tournait le dos aux logiques de puissance. Elle s’engageait dès ses premiers pas vers ce que ses fondateurs ont pressenti être un modèle précurseur du « monde de demain ». Ce « monde de demain », c’est notre monde d’aujourd’hui. Parce qu’elle s’est -pensée comme une réponse de long terme aux désordres du monde et de l’histoire, parce qu’elle a gagé son succès sur des solidarités parta-gées, l’Europe a acquis la capacité d’agir sur les logiques du capitalisme de marché et, aujourd’hui, de répondre à la mondialisation. Car c’est bien ce monde-là qui a été anticipé, dès sa conception.
Certains reprochent ce choix des origines à l’Europe. Aujourd’hui, au discours classique du souverainisme qui défend la persistance de l’État-nation contre les « machins » supranationaux, se superpose un autre discours, qui accuse l’Europe d’être la courroie de transmission de la « mondialisation néolibérale » : en d’autres termes, d’être un nouvel instrument d’aliénation. La conjugaison actuelle de ces deux discours me conduit à deux réflexions. La première : cette conjugaison relève-t-elle d’une coïncidence historique ou faut-il y voir l’effet d’une commune inspiration, qui serait finalement celle du souverainisme classique, quitte à se mettre en contradiction avec les principes universalistes de certains mouvements altermondialistes ? Seconde réflexion : ce qui était une vision d’avenir pour Jean Monnet est aujourd’hui notre réalité ; mais, partant, l’irruption du monde dans nos sociétés a transformé le projet européen. Dès lors, il me semble que la confusion des débats actuels vient du fait qu’aujourd’hui, on ne peut plus penser l’Europe sans penser le monde, et inversement. Le travail d’éclaircissement indispensable sur le projet européen et sur les difficultés qu’il rencontre ne peut donc être mené qu’en résonance avec les questions que pose la mondialisation. Et tant pis pour ceux qui voudraient faire de l’Europe une forteresse isolée.
Face à nombre d’aspects de la mondialisation, les États sont démunis. Ils ne peuvent plus espérer régler, seuls, des problèmes qui se développent dorénavant à l’échelle globale. Or, dans le même temps, les formes de la légitimité démocratique indispensables à la prise en charge de ces questions ne migrent pas vers la scène internationale : elles demeurent inscrites dans le sein des États-nations. Cette contradiction a ouvert une double faille dans notre vie politique : d’un côté, les institutions internationales théoriquement en charge des questions globales sont soupçonnées d’illégitimité ; de l’autre, les démocraties nationales n’ont pas, seules, les moyens de maîtriser les mutations globales. En somme, ceux qui ont la compétence manquent de légitimité, et ceux qui ont la légitimité manquent de compétence. Cette contradiction alimente notamment, en Europe, la crise qui frappe nos démocraties, affectées par le retour des expressions populistes et des tentations de repli. Comment résoudre de façon démocratique cette contradiction ? Comment répondre à cette crise de la démocratie que ressent une partie grandissante de nos opinions publiques ? Un pouvoir démocratique s’appuie sur trois piliers. Des éléments de légitimité d’abord : ils sont ancrés dans des institutions et dans des procédures - un État de droit fondé sur la séparation des différents pouvoirs et la représentation politique du peuple, qui garantit aux citoyens la possibilité de choisir collectivement leurs représentants par l’expression du suffrage -, mais aussi dans la capacité du politique à produire un discours et une offre susceptibles de fédérer des majorités cohérentes, c’est-à-dire de figurer la société, de la rendre lisible à elle-même, de la rassembler sous une parole et des affects collectifs. Tout pouvoir démocratique se fonde ensuite sur son efficacité, c’est-à-dire sur sa capacité à identifier les problèmes de la vie en commun, à faire émerger des solutions, à proposer différentes options au débat public et, enfin, à résoudre ces problèmes. En ce sens, le pouvoir démocratique est un pouvoir responsable : il ne doit pas seulement s’appuyer sur une majorité, il doit également répondre de ses actes. Quant au dernier pilier, il consiste dans un espace public de confrontation, de débat, de discussion des enjeux et de caractérisation politique des solutions. Pour que cet espace soit à la fois visible et compréhensible, il doit être animé d’une mise en scène plus ou moins ritualisée du combat politique entre partis ou champions concurrents. C’est la combinaison de ces trois aspects qui contribue à construire le sentiment d’adhésion des citoyens, c’est-à-dire le sentiment qu’ils peuvent infléchir les choix de leur société et se reconnaître dans leurs représentants, qu’ils sont maîtres, collectivement, de leur destin dans un espace dont les repères sont explicites et familiers. C’est, pour moi, cette dimension ressentie de la démocratie qui en constitue le véritable et plus profond ressort. Et c’est en interrogeant ce sentiment de la démocratie, que l’on peut poser, aujourd’hui, le diagnostic de la crise qui frappe l’ensemble des systèmes démocratiques. Car si les citoyens n’ont plus la conviction de jouer un rôle central, les plus belles courroies de transmission de la démocratie institutionnelle, les plus beaux arrangements formels resteront des pantins sans vie. Aujourd’hui, force est de constater que la crise est là. Le gros temps déferle sur le système international, sur l’Europe et sur les démocraties nationales - trois échelons de pouvoir interrogés à la lumière d’une triple exigence : de légitimité, de compétence et, pour finir, d’adhésion. C’est pourquoi la nécessité d’une nouvelle organisation démocratique des pouvoirs qui dépasserait le cadre des États-nations - matrice historique, juridique, politique et culturelle de nos sociétés - relève aujourd’hui de l’urgence. Dès lors que, à l’exception de quelques « éléphants continentaux » (États-Unis, Chine, Inde), l’État-nation pâlit, l’absence de gouvernance internationale démocratique pose un problème vital à la démocratie. Or, nous ne pouvons ni abandonner la poursuite d’un bien commun global - ce qui nous condamnerait à subir les désordres actuels du monde -, ni laisser flétrir nos démocraties sous l’effet grandissant du sentiment de dépossession de leur propre destin que manifestent nos concitoyens. Comment réagir ? C’est ce que je me propose d’explorer dans ce livre. Le détour par l’Europe s’impose : la construction européenne est, sur la planète, la forme la plus avancée d’invention d’un système de gouvernement démocratique alternational et non hégémonique. Son analyse au crible de la contradiction démocratique que j’ai relevée doit nous permettre d’avancer dans la recherche de nouvelles réponses. C’est cette réflexion, nourrie de mon voyage en terre européenne et dans le monde, que je souhaite livrer à qui souhaite être témoin et acteur du futur.

 Mots-clés :
Mots-clés :