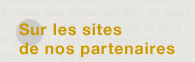Les multinationales du cœur
Les grandes organisations non gouvernementales (ONG) comme Greenpeace, MSF ou Oxfam ne forment pas un monde à part à l’abri du pouvoir et des eaux glacées du marché. Au contraire, elles s’inscrivent bien souvent dans un large réseau de relations avec les États, les institutions internationales et les grandes entreprises. Autrement dit, les lignes de démarcation d’hier sont devenues des espaces mitoyens où les « multinationales du cœur » nouent volontiers des collaborations avec leurs nouveaux voisins. Cette face cachée de leur travail est le laboratoire d’une vaste redistribution des rôles entre les acteurs publics, la sphère marchande et la société civile. À l’écart des oppositions routinières et des procès faciles, cet essai tente de penser la complexité et la fécondité de ces relations. Car les grandes ONG y œuvrent de concert à la redéfinition des stratégies d’action publique, à la recherche d’une légitimité internationale et à l’expérimentation de nouvelles régulations du capitalisme. Un jeu où les adversaires supposés sont parfois les meilleurs alliés. Et inversement.
La mondialisation brouille les frontières : celles des États et du marché, du public et du privé, des institutions et de la société civile, procurant à beaucoup le sentiment de vivre dans un âge de turbulences et de confusion. Pourtant, malgré le bouleversement des espaces, l’affaiblissement des régulations anciennes et l’émergence de risques nouveaux, la mondialisation n’est pas un chaos indéchiffrable : des logiques s’y affirment, des acteurs y jouent leur carte, des choix idéologiques s’y affrontent. À la fois portées par ces transformations et désireuses d’y introduire des valeurs et des solidarités nouvelles, les grandes organisations non gouvernementales (ONG) comme Greenpeace, Amnesty International ou Médecins sans frontières offrent un point d’observation privilégié pour analyser plus clairement l’actuelle redistribution des rôles entre les sphères politique, marchande et civile. Ces organisations au fonctionnement de multinationales philanthropiques ont su, depuis une trentaine d’années, se construire l’image d’un monde à part conjuguant tous les traits de l’héroïsme moderne : désintéressement, indignation, volontarisme, indocilité à tous les pouvoirs, impatience au changement, prise de risque, fidélité à quelques valeurs universelles... Réputées affranchies des logiques politique et commerciale, jugées implacables à l’égard des institutions internationales, elles semblent avoir investi, dans l’imaginaire occidental, la place laissée vacante par les grands récits collectifs : les French doctors sont nos nouveaux missionnaires, et les Ecowarriors nos croisés laïcs. Bref, elles se sont installées au cœur de nos mythologies politiques. À l’épreuve des faits, ces représentations révèlent pourtant leur extraordinaire candeur. « Non gouvernementales », ces organisations n’en sont pas moins, pour les gouvernements, d’éventuels relais pour continuer la politique par d’autres moyens. Étrangères à la sphère du profit, elles ne craignent plus de contracter avec des multinationales, de s’impliquer dans des fonds d’investissement, d’intervenir comme des organismes bancaires dans le micro-crédit, d’organiser des opérations commerciales d’envergure et de se livrer entre elles une concurrence parfois féroce. Enfin, en dépit de leurs fréquentes attaques contre les institutions internationales, elles ne dédaignent ni leurs fonds, ni leur accréditation, et utilisent à l’envi leurs rendez-vous pour faire valoir leurs revendications. De fait, il est devenu pratiquement impossible de décrire le monde des grandes ONG comme un territoire sanctuarisé, indemne du pouvoir et du marché. Ce qu’il faut examiner dès lors, ce sont leurs relations avec les autres acteurs. Or, celles-ci restent largement impensées. Tandis que les pratiques se complexifient, l’essentiel des débats se noue autour d’oppositions simples, voire caricaturales : les ONG contre les États, contre la politique, contre les multinationales, etc. La mythologie du contre-pouvoir absorbe le plus clair des énergies intellectuelles sur le sujet, que ce soit pour la louer ou pour la blâmer. D’un côté, on pleure le baroudeur sac-au-dos des origines, le temps des pionniers, la chevalerie humanitaire des commencements. Quoi de commun entre le rebelle idéaliste des années 1970 et le logisticien, l’hydraulicien ou le directeur des ressources humaines des années 2000 ? La générosité et l’esprit de sacrifice auraient laissé la place au pragmatisme, au professionnalisme et au culte de la performance. Et la gratuité, la culture du don, aux grasses rémunérations des responsables d’inaccessibles sièges londoniens, new-yorkais ou parisiens. Qu’importe que les ONG soient ainsi sorties d’une adolescence prolongée : en franchissant la frontière qui les séparait du monde et des méthodes de l’entreprise, elles auraient perdu leur âme. De l’autre, elles sont au contraire brocardées pour leur radicalisme, leur propension à étendre sur toutes choses le règne d’un « droit-de-l’hommisme dogmatique » ou d’un « cosmopolitisme libertaire ». Ainsi, des États démocratiques et des gouvernements élus seraient fragilisés par le « robespierrisme » globalisé d’organisations à la représentativité douteuse, mais dotées d’une redoutable puissance de feu médiatique. L’heure serait venue de défendre l’État contre les ONG, de les « remettre à leur place ». Bref, dans tous les cas, il s’agirait de réaffirmer entre les sphères politique et marchande, d’une part, et civile, de l’autre, une frontière suffisamment étanche pour protéger leur intégrité respective. La montée en puissance des grandes ONG internationales1 pose certes bien des problèmes, mais il serait un peu court de leur en imputer l’entière responsabilité. Car elles participent bien souvent de mutations qui les dépassent : mutations de l’action publique, de la légitimité internationale, du capitalisme. De ces transformations, MSF, WWF ou Oxfam2 sont à la fois les laboratoires les plus avancés et les meilleurs témoins, pour peu que l’on accepte de vivre avec l’incertitude des frontières et de penser l’hybridation des genres. C’est tout le sens de cet essai.
Pour bien le voir, il faut d’abord se débarrasser d’un certain nombre de mythes et tenter de décrire plus précisément ce nouveau monde des ONG. Le label « ONG » est très largement une catégorie par défaut : on range là tout ce que l’on a pas su placer ailleurs. Au regard des définitions les plus courantes, un syndicat ou une association sportive ne sont ni plus ni moins des ONG qu’Amnesty International. Car ces structures auraient en commun de ne relever ni de la sphère publique, ni de la sphère marchande3. Loin des eaux glacées du calcul politique et du profit, elles afficheraient ainsi une forme de virginité certifiée par le droit et célébrée par le sens commun. Le droit avalise en général, dans les démocraties libérales, le principe de cette double exclusion : « ni l’État, ni le marché4 ». La première est lisible dans la qualification « non gouvernementale », tirée de l’article 71 de la Charte des Nations unies : ce sont des organisations de constitution privée, c’est-à-dire créées par des personnes physiques ou morales relevant du droit privé, et non d’un décret ou d’un traité entre États. La seconde consiste dans leur caractère non lucratif. Ce qui n’interdit pas, en général, l’exercice de certaines activités économiques (perception de revenus financiers ou immobiliers, ventes de biens ou de services), pourvu qu’elles n’entrent pas en concurrence avec les entreprises du secteur marchand5. On peut ajouter une troisième caractéristique : les ONG doivent afficher une vocation d’utilité sociale. En tant que telles, elles sont dépositaires d’une forme de légitimité qui ne peut être mesurée au nombre de leurs membres, mais d’abord à la justice de la cause qu’elles défendent. La généralité de cette cause, voire son universalité, projette ces organisations privées sur le terrain naturel des États, représentants légitimes de l’intérêt général. Mais, qu’elles concurrencent ou qu’elles prolongent le travail des acteurs publics, dans tous les cas, elles ont vocation à influencer leur environnement en endossant le rôle de contre-pouvoirs spontanés ou de corps intermédiaires plus organisés. Ainsi présentées, elles répondraient parfaitement à la définition de la « société civile globale » selon Jan Aart Scholte : le lieu des activités volontaires, hors État et hors marché, qui ont pour but d’influencer les politiques, la formation des normes ou les structures de la société6. Souvent citée, cette définition repose pourtant sur un postulat discutable : celui de l’extériorité radicale à la sphère publique et à celle du profit. En outre, elle ne permet de distinguer ni entre les organisations nationales et internationales, ni entre les différentes structures qui composent cette société civile : réseaux, mouvements sociaux, organisations professionnelles, coopératives, instituts de recherches... Si l’on prend pour modèle des organisations comme Greenpeace, Oxfam ou Médecins sans frontières, il faut convenir que les grandes ONG n’ont que peu de points communs avec ces différents modèles. Moins « lestées » que les mouvements sociaux - que l’on songe à la Confédération paysanne par exemple - par une base localement enracinée, elles ne dépendent qu’indirectement de la satisfaction de membres devant lesquels elles ne sont en général pas formellement responsables et dont le rôle stratégique se mesure moins au nombre qu’à la hauteur des dons. Contrairement aux réseaux associatifs modernes, elles disposent le plus souvent d’une organisation assez hiérarchisée : le cas limite de Greenpeace International où une poignée de responsables prennent les décisions pour l’ensemble de la structure montre la distance qui sépare un tel modèle des utopies associationnistes qui prévalent sur les nouveaux réseaux. Les grandes ONG sont-elles plus proches du tiers-secteur ? Les organisations les plus typiques de cet ensemble situé entre le public et le privé (coopératives, mutuelles, etc.) fonctionnent en général sur le régime de l’auto-assistance et de l’entraide : leurs membres constituants sont en même temps leurs bénéficiaires et peuvent à ce titre prendre part aux décisions. Rien de tel dans l’univers des grandes ONG. En ce sens, elles seraient plutôt un sous-secteur du secteur privé7. Enfin, contrairement à certains instituts de recherches antimondialistes et autres « mouvements d’éducation populaire » qui produisent essentiellement du discours et de l’information, elles ne se comportent pas comme de simples médias militants. Beaucoup d’entre elles fonctionnent aussi comme des prestataires de services (assistance humanitaire, aide logistique, soins, soutien à la création d’entreprises...). En somme, les grandes ONG s’apparentent bel et bien à un autre modèle : celui de l’entreprise privée à but non lucratif. Elles peuvent s’associer à des mouvements sociaux ou participer à des réseaux à l’occasion de certaines campagnes, mais elles se situent fondamentalement dans des logiques très différentes. Autrement dit, l’idée d’une « société civile » homogène et conçue comme une force sociale autonome est à bien des égards un artifice : si elle existe, c’est tout au plus comme un champ de forces où se côtoient et parfois se confrontent des organisations de nature distincte.
Les grandes ONG ont une autre caractéristique que ne partagent pas toujours leurs voisines : leur dimension internationale. Celle-ci est souvent surestimée : on parle d’elles un peu rapidement comme d’organisations « globales » alors que leur géographie est solidement ancrée au nord et plus précisément en Europe occidentale. Il n’empêche qu’elles sont authentiquement internationales, tant par leurs implantations que par leurs revendications. Leur explosion démographique (voir « Annexe8 ») est d’ailleurs en partie liée aux mutations du système international. Pour les « réalistes9 », elles doivent en effet leur montée en puissance à des facteurs qui les dépassent : elles fleuriraient dans les périodes de construction multilatérales (les années 1920, l’après-1945, l’après-1989...) et s’étioleraient dans les périodes de tension, de recrudescence des nationalismes et de retour des logiques de puissance (1914-1918, 1937-1945...). Les temps de guerre en particulier leur seraient fatals. En réalité, cette lecture est trompeuse. D’une part, la guerre est aussi un moment de refondation pour des ONG qui, il faut le rappeler, sont nées sur le champ de bataille10 et puisent dans la destruction des combats une partie de leur raison d’être. De fait, le déchaînement de la puissance des États suspend et réarme simultanément les énergies de cette société civile : selon un scénario désormais rodé, les 4x4 des urgencières suivent de peu les jeeps et les bombes. D’autre part, en dépit des périodes de recul, le solde de cette histoire est très largement positif sur le long terme pour les ONG internationales. Il faut donc recourir à d’autres instruments pour s’expliquer le boom de ces organisations, en particulier sur la dernière période. C’est bien davantage dans l’histoire des idées et des dynamiques culturelles qui sous-tendent le souci civil du monde que se trouve l’explication. Jusqu’aux années 1960, ce souci est porté principalement par trois grands courants : le mouvement caritatif d’inspiration chrétienne, l’internationalisme ouvrier et le mouvement humaniste (avec, en particulier, ses organisations de défense des droits de l’homme). Ces courants vont continuer d’exercer une certaine influence, mais les trois générations d’ONG qui vont suivre modifient considérablement la donne. La première qui apparaît au seuil des années 1970 est marquée par la culture d’émancipation des « 68 » européens et américains : l’antimilitarisme, le pacifisme, l’écologie, le refus du consumérisme, le rejet des différentes formes d’impérialisme et du cynisme de la Realpolitik... Deux ONG sont emblématiques de cette histoire : Greenpeace et MSF11. Fondées en 1971, elles inventent le « sans-frontiérisme » moderne, cette idée que l’on peut agir sur le monde sans passer par la médiation du pouvoir politique et des institutions, mais avec le secours des médias et des opinions publiques. Très vite, le « sans-frontiérisme » en vient à se définir à la fois comme une idéologie et comme une stratégie : mobiliser les affects collectifs de la colère et de la pitié à des fins pratiques de soulagement de la souffrance et d’amendement de la politique ; faire honte aux démocraties pour transformer le monde. Las des lenteurs et des prudences des procédures institutionnelles, on parie sur la solidarité des émotions et les raccourcis d’un refrain devenu un hymne : We are the World12. La deuxième génération (des accords d’Helsinki à la chute du mur de Berlin) est marquée, elle, par les débats sur le totalitarisme et la dissidence. Ce sont les années de la « Charte 77 », de Solidarnosc et des campagnes d’Amnesty contre les dictatures latino-américaines. Cette génération déplace la critique des États sur le terrain des droits de l’homme et des droits civils et politiques, et fait de l’État de droit l’un des horizons les plus mobilisateurs. C’est dans ce contexte que le concept de « société civile » fait retour. Certaines grandes ONG voient alors le jour, comme Human Rights Watch. La troisième génération (de 1989 à nos jours) est de loin la plus complexe. Elle ouvre un cycle à la fois de consécration et de fragilisation. Les grandes ONG n’ont sans doute jamais été aussi puissantes et reconnues : les États les financent davantage, les institutions internationales commencent à les écouter, des multinationales les approchent, et beaucoup les considèrent comme des instruments indispensables de démocratisation et de transitions politiques réussies. Mais leur « sans-frontiérisme » doit faire face à l’émergence d’une force culturelle concurrente, tout aussi internationale, quoique moins sûrement internationaliste : l’antimondialisme. Ainsi, ces années sont à la fois une période d’adaptation laborieuse aux brusques transformations du paysage idéologique, et de recomposition de leur rapport aux acteurs publics et marchands. Les grandes ONG sont à la fois des sommets et des contre-sommets, dans les couloirs de la Banque mondiale et dans les rues de Porto Alegre, à l’ONU avec Kofi Annan et au Larzac avec José Bové. Entre « autre monde » et nouveau monde : une ambiguïté dont elles sont loin d’être sorties.
Nous nous attarderons moins ici sur leur participation aux différentes formes de contestation globale - omniprésente marotte médiatique - que sur leur intégration croissante au nouveau jeu international - véritable non-dit médiatique. Loin de former un camp retranché de la vertu, les grandes ONG participent aujourd’hui d’un vaste réseau de relations avec les États, les institutions internationales et les acteurs économiques privés. Certains dénoncent volontiers ces rapprochements et les intrigues de cette « société civile d’en haut » au nom de la « société civile d’en bas13 ». Nous en soulignerons plutôt la fécondité. Nous montrerons ainsi que l’opposition traditionnelle entre les ONG et les acteurs publics masque en réalité diverses formules de collaboration où s’expérimentent de nouvelles stratégies d’actions publiques dans les domaines du développement et de l’aide humanitaire (chapitre premier). Nous montrerons également que, derrière les conflits de légitimité entre ONG et institutions internationales, se joue une autre partie beaucoup plus décisive : la coproduction d’une légitimité internationale et l’invention hésitante d’une vie politique transnationale (chapitre II). Enfin, nous montrerons que les rapports entre ces organisations et les multinationales ne se résument pas à une guerre des cultures : ils sont aussi le laboratoire de nouvelles régulations du capitalisme (chapitre III). Une interrogation traversera chacune de ces réflexions : les ONG n’auraient-elles pas trahi leur acte de naissance ? Si l’on en juge par leurs discours, il n’y aurait pas lieu de s’inquiéter : elles présentent toujours au public un profil très combatif. Mais le problème est ailleurs : pourquoi ces organisations entretiennent-elles une présentation d’elles-mêmes de plus en plus décalée par rapport à leurs pratiques ? N’est-ce pas plutôt en réglant leur discours sur la réalité de leur travail, qu’elles se donneraient quelques chances de réconcilier le souci du monde et les exigences d’une politique ? Car c’est bien d’une politique des ONG qu’il s’agit. Au double sens du terme : une stratégie pour agir, mais aussi un espace de discussion, de négociation, voire de collaboration entre les acteurs, publics ou privés, qui concourent à la définition du vivre-ensemble. Vivre ensemble, nous y sommes : serait-ce le privilège (ou le fardeau) exclusif de ceux que réunit la communauté nationale ? Ou bien l’horizon que la mise en rapport du prochain et du lointain - ce que l’on pourrait appeler la mondialisation - assigne à chacun par-delà cette communauté ? C’est au fond cette question que nous posent les grandes ONG.

 Mots-clés :
Mots-clés :