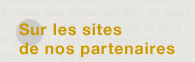Le Capitalisme total
Le capitalisme moderne est organisé comme une gigantesque société anonyme. A la base, 300 millions d’actionnaires contrôlent la quasi-totalité de la capitalisation boursière mondiale, et confient la moitié de leurs avoirs à quelques dizaines de milliers de gestionnaires dont le seul but est d’enrichir leurs mandants. Les techniques pour y parvenir s’appuient sur les règles du « gouvernement d’entreprise » et conduisent à des exigences de rentabilité excessives. Elles transforment les chefs d’entreprise en esclaves dorés des actionnaires, et polluent de pure cupidité la légitime volonté d’entreprendre. Ainsi le capitalisme est devenu « total » : il règne sans partage ni contre-pouvoir sur le monde et ses richesses.
Introduction
Après la chute du mur de Berlin et la faillite du communisme, le capitalisme s’est imposé comme modèle unique d’organisation de la vie économique mondiale. Raison suffisante pour regarder de près si les lois propres de l’économie de marché sont compatibles, voire spontanément cohérentes, avec l’intérêt général de la société ou si elles en demeurent au contraire distinctes par nature. En d’autres termes, une certaine forme d’optimum collectif peut-elle être atteinte à travers le fonctionnement naturel de l’appareil capitaliste, l’affirmation de ses règles de gouvernance et le comportement de ses acteurs (actionnaires, conseils d’administration et mandataires sociaux) ? Ou bien, à l’inverse, la divergence des objectifs, pour ne pas dire des destins, entre la partie la plus évoluée de l’appareil productif et l’ensemble de la collectivité citoyenne appelle-t-elle en réaction une régulation forte, externe, souveraine de l’économique par le politique ? Ou bien encore la notion de développement durable, c’est-à-dire respectueux de l’environnement, des ressources naturelles et de l’équité sociale, peut-elle être internalisée sans contrainte par une sphère productive qui y trouverait son intérêt ou doit-elle lui être imposée parce qu’elle lui serait antinomique ?
La réponse est malheureusement sans ambiguïté. Nous sommes entrés dans l’ère d’un capitalisme triomphant mais dissocié. Les dirigeants d’entreprise ne sont plus que les serviteurs des actionnaires dont ils poursuivent l’enrichissement : aucune autre préoccupation ne peut plus inspirer leur action. Le capital, internationalement mobile, commande à un facteur de production travail qui reste terriblement fragmenté et dont les intérêts sont défendus par des pouvoirs politiques locaux, identitairement et culturellement structurés mais rendus impuissants par leur émiettement. Ainsi les États-Unis, premiers propriétaires du monde, ont-ils imposé leur vision fondée sur le primat d’une liberté absolue d’entreprendre au service de l’enrichissement sans bornes des détenteurs du capital. Ainsi le modèle européen, qui cherche à concilier dynamisme économique et progrès social, est-il menacé de disparition.
Le capitalisme moderne est organisé comme une gigantesque société anonyme, une société de propriétaires également anonymes. À la base, trois cents millions d’actionnaires, concentrés à 90 % en Amérique du Nord, en Europe occidentale et au Japon, contrôlent la quasi-totalité de la capitalisation boursière mondiale. Souvent d’âge mûr, de formation supérieure, avec un niveau de revenus relativement élevé, ils confient la moitié de leurs avoirs financiers à quelques dizaines de milliers de gestionnaires pour compte de tiers (SICAV, fonds mutuels, fonds de pension, caisses de retraite et compagnies d’assurances) dont le seul but, mondialisation aidant, est d’enrichir leurs mandants. Les techniques pour y parvenir sont similaires de part et d’autre de l’Atlantique ou du Pacifique, et s’appuient pour ce faire sur les règles, sans cesse durcies et devenues universelles, du corporate governance - littéralement, la « gouvernance d’entreprise ». La pointe visible de l’iceberg est constituée de quelques milliers d’entreprises cotées dont les dirigeants trouvent leur prospérité dans l’application zélée des codes qui leur sont imposés.
L’humanité, depuis l’origine, lutte contre la rareté. Ainsi le désir d’enrichissement est-il passé dans nos gènes comme élément constitutif de la volonté d’entreprendre et de prospérer. Mais ténue est la frontière qui le sépare de la pure cupidité. Que celle-ci triomphe et la croissance se dévoie au point de ne plus répondre aux besoins de toute la société. Animés par un jeu de plus en plus spéculatif, les marchés financiers connaissent ainsi une volatilité accrue. Gains et pertes s’y forment de manière aléatoire, au gré de la formation et de l’éclatement des bulles qui anticipent un futur virtuel et, oubliant la lente évolution des mouvements structurels, le ramènent tout entier sur l’instant présent. Des normes de rentabilité excessives conduisent les chefs d’entreprise à être les premiers agents d’une mondialisation sans frontière et à implanter leurs activités partout où ils peuvent trouver une main-d’œuvre moins onéreuse. Dans le même temps, de leur adoption découle un sous-investissement ennemi du plein emploi et une vague de concentrations qui, bien ou mal fondée, touche peu à peu toutes les branches.
Bien sûr, cette formidable mécanique fabrique de la croissance, ce qui la justifie aux yeux des gouvernants et fonde sa pérennité. Mais elle a de redoutables effets externes : aucun contre-pouvoir digne de ce nom ne permet de lutter contre la pollution, l’épuisement des ressources naturelles, l’extension de l’effet de serre qui fait peser un grave danger sur l’espèce, ou les inégalités de développement. La moyenne des revenus des pays dits du Nord est trente-sept fois supérieure à celle des vingt pays les plus pauvres du monde. Ceux-ci ploient sous le service de leur dette qui les empêche d’investir pour la santé, l’éducation ou les programmes d’adduction d’eau qui leur seraient nécessaires pour espérer sortir de la misère. Une nouvelle frontière sépare le monde entre pays riches et pays pauvres, entre les actionnaires et le reste des mortels.
Jamais nous n’avons eu autant besoin de régulation pour assurer l’équilibre politique, éthique, écologique du développement de la planète. Jamais nous n’en avons été aussi éloignés, jamais la distance entre le souhaitable et le réel ne s’est accrue aussi vite. Pour trois raisons dont la convergence est redoutable. Les pouvoirs nationaux, accrochés aux derniers lambeaux d’une souveraineté dépassée, n’ont ni le goût ni les moyens de remettre en cause, chacun pour soi, un mouvement général créateur de prospérité dont ils cherchent, faute de pouvoir le contrôler, à tirer égoïstement le meilleur parti : à cet égard, l’économie de marché est sans rivale historique, tous les autres modèles ayant échoué. Pauvre, en outre, est la pensée qui constituerait le fondement soit d’un capitalisme maîtrisé, soit d’un antilibéralisme raisonné, selon le point où l’on entend placer le curseur de la régulation sur l’échelle des libertés économiques. Les œuvres intellectuelles qui devraient analyser, détailler, critiquer le fonctionnement de ce nouvel univers sont soit absentes (n’est-il pas tellement plus amusant de se consacrer à des querelles villageoises ?), soit creuses faute de compréhension réelle des mécanismes qui nous gouvernent. Ainsi et enfin, la révolte altermondialiste est-elle souvent juste dans ses intentions et inexistante dans ses propositions. En ce sens elle devient l’allié objectif, non l’adversaire, du système qu’elle prétend combattre.
Seul le retour improbable du politique (mais sous quelle forme et à quels niveaux ?) permettra de redécouvrir les voies d’un développement plus équilibré.

 Mots-clés :
Mots-clés :