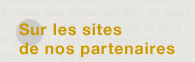Trois leçons sur l’État-providence
Pour beaucoup aujourd’hui, les dépenses de l’État-providence (retraites, assurance-maladie...) sont un coût qu’il s’agit sinon de réduire, en tous cas de contenir. Et si elles devenaient un investissement ? Un investissement dans l’avenir, non seulement pour protéger les individus contre les aléas de la vie, mais pour les aider à rester maîtres de leur destin tout en répondant aux défis économiques de demain ? C’est à cette révolution sociale et politique que nous invite le grand sociologue Gøsta Esping-Andersen.
PRÉSENTATION
Quel État-providence pour les sociétés post-industrielles vieillissantes ?
Par Bruno Palier
Alors que l’avènement de l’économie
post-industrielle a remis en cause les compromis qui ont porté la
croissance des États-providence européens [1], les grandes évolutions
sociales récentes (entrée des femmes sur le marché du travail,
vieillissement de la population, inégalités croissantes...) appellent
de nouvelles interventions. Est-il aujourd’hui possible de trouver les
nouveaux compromis qui permettraient de redéfinir les missions de
l’État-providence au XXIe siècle ? Les trois leçons que l’on va lire proposent
une véritable révolution dans l’approche de cette question.
Elles proposent de substituer à une conception traditionnelle et statique
des politiques sociales, visant à réparer les situations les plus
difficiles ou bien à remplacer les revenus perdus, une perspective
dynamique prenant en compte les trajectoires des individus, leurs
aléas dans l’économie de la connaissance, et l’émergence de nouvelles
inégalités entre les genres, les générations et les groupes sociaux propres
aux sociétés post-industrielles. Cette approche montre que les
politiques sociales ne peuvent plus se contenter d’être des dispositifs
d’indemnisation, mais qu’elles doivent porter une stratégie collective
d’investissement social. Bref, il s’agit de passer d’un État-providence
essentiellement « infirmier », à un État-providence « investisseur ».
État-providence et société industrielle
Les systèmes d’assurance sociale, figure principale de l’État-providence
en Europe continentale, sont l’émanation et le support
de la société industrielle. Ils naissent au XIXe siècle avec la révolution
industrielle et son corrélat social : l’émergence du salariat [2].
Destinées à garantir la continuité du revenu des ouvriers qui
ont perdu les solidarités familiales et locales de la société agricole,
elles permettent en même temps aux patrons de s’assurer la fidélité,
la stabilité et la qualité de leur main-d’oeuvre.
Au cours des trente années qui suivent la Seconde Guerre
mondiale, le fordisme et les approches keynésiennes des politiques
économiques vont permettre une véritable explosion des dépenses
sociales (de 5 à 25 % du PIB en moyenne en Europe). Pendant
cette période, les politiques économique et sociale semblent se
renforcer l’une l’autre. Les dispositifs de protection sociale permettent
alors de soutenir et de relancer la croissance économique :
ils sont créateurs d’emploi (professions sanitaires, sociales et d’administration
de la protection sociale) ; ils permettent de soutenir
la capacité à consommer de ceux qui ne peuvent plus travailler
(pour cause de maladie, chômage, vieillesse, invalidité) ; dans la
mesure où ils garantissent une sécurité du revenu, ils libèrent
l’épargne de protection et permettent de consacrer une part croissante
des revenus à la consommation ; ils sont aussi des instruments
de relance de la consommation (par le biais d’une
augmentation des prestations sociales ou de créations d’emplois
dans les services sociaux publics). La croissance économique des
« Trente glorieuses » (1945-1975) repose en grande partie sur
les interactions vertueuses entre développement de l’industrie de
biens standardisés de grande consommation, consommation
de masse et généralisation de la protection sociale.
Utile à l’économie, la protection sociale permet en même
temps de répondre aux besoins sociaux de l’époque : améliorer la
santé de la population dont l’espérance de vie dépasse rarement
65 ans, lutter contre la pauvreté, qui est alors - et depuis longtemps - concentrée sur les personnes âgées, et soutenir la nouvelle
répartition des rôles sociaux. Alors que dans les sociétés
agricoles, tout le monde travaillait à la ferme (les hommes, les
femmes et les enfants), la société industrielle définit une nouvelle
répartition des tâches, où les hommes garantissent le revenu et la
protection sociale de l’ensemble du ménage, les enfants sont de
plus en plus scolarisés, et les femmes supposées rester à la maison
et prendre en charge les travaux domestiques.
Si tous les États-providence développés partagent les fonctions
de soutien à la demande et d’indemnisation des risques
sociaux, les différents pays occidentaux n’ont pas tous mis
en place les mêmes dispositifs de protection sociale. On peut
regrouper les systèmes de protection sociale en trois grandes
familles ou régimes (le régime social-démocrate des pays scandinaves,
le régime libéral des pays anglo-saxons, le régime
conservateur-corporatiste des pays d’Europe continentale) [3], en différenciant à la fois les objectifs politiques et sociaux qu’ils cherchent à atteindre (respectivement : l’égalité des citoyens, la
seule couverture sociale des plus pauvres, le maintien du revenu
des travailleurs) et les instruments qu’ils utilisent à cet effet (respectivement
: politiques universelles et services sociaux gratuits,
politiques sociales ciblées, assurances sociales financées par des
cotisations sociales). À l’heure où les conditions économiques
et sociales changent, ce sont les systèmes de protection sociale
d’Europe continentale, les plus ancrés dans l’industrialisme, qui
rencontrent les difficultés les plus grandes.
Les divorces
L’ouverture progressive des économies et l’arrivée de nouveaux
pays dans le jeu économique mondial ont déstabilisé les
économies industrielles traditionnelles et remis en cause les relations
entre politiques économiques et politiques sociales. La
compétition croissante que se font les entreprises européennes
entre elles pèse sur les coûts, et notamment les coûts non salariaux
comme ceux issus du financement de la protection
sociale par cotisation sociale. La mondialisation des échanges, la
circulation des capitaux ont déplacé les activités économiques,
délocalisant vers l’Est (en Europe, mais surtout en Asie) les activités
industrielles de masse, reposant sur une main-d’oeuvre
ouvrière peu chère et peu qualifiée. Cette évolution conduit les
pays anciennement industrialisés à se reconvertir dans de nouvelles
activités post-industrielles, fondées à la fois sur l’innovation
technologique, les hautes qualifications, le savoir, et sur les
services (qualifiés ou non), notamment les services à la personne [4].
Les protections fondées sur les assurances sociales, conçues à l’origine
pour protéger les ouvriers industriels peu qualifiés ayant un contrat à durée indéterminée, le plus souvent dans les secteurs
industriels ou de services classiques, s’avèrent mal adaptées pour
protéger des parcours professionnels plus mobiles, plus chaotiques,
souvent plus précaires, typiques de la nouvelle économie.
De plus en plus de personnes, mais surtout de nouveaux groupes
se retrouvent en difficulté (les jeunes, les femmes, les personnes
non qualifiées...). Ces personnes ne sont pas forcément les mieux
protégées par les systèmes existants. Les travailleurs salariés protégés
se retrouvent eux-mêmes dans une situation plus précaire,
du fait des évolutions démographiques comme des mutations
économiques qui risquent d’affaiblir leurs protections autrefois
bien établies.
Dans ce nouveau contexte, les politiques sociales semblent
être devenues contre-productives : en raison de leur mode de
financement et de la compétition fiscale entre les États, elles sont
dénoncées comme un coût, et non plus présentées comme un
moyen de soutenir l’économie. Elles semblent parfois soutenir
l’inactivité plutôt que l’activité : multiplication des systèmes
de préretraite (Allemagne, France, Belgique), nombre croissant
de bénéficiaires d’allocation invalidités (aux Pays-Bas notamment),
aide au maintien voire au retour des femmes au foyer
(Allemagne). Il s’agit là d’une évolution paradoxale des politiques
sociales : partant d’une situation où elles devaient soutenir
le plein-emploi, elles ont peu à peu été utilisées pour retirer des
individus du marché du travail. De telles politiques ont conduit
à une hausse des dépenses de protection sociale non compensée
par de nouvelles ressources.
Les politiques sociales construites dans l’après-Seconde
Guerre mondiale sont de plus en plus « désajustées » économiquement,
mais aussi socialement. Pas plus que l’économie postindustrielle
ne ressemble à l’économie industrielle, la société
post-industrielle ne ressemble à la société industrielle. Dans cette
nouvelle société, les femmes travaillent, les couples divorcent, la
fécondité baisse, l’espérance de vie s’allonge considérablement, la
pauvreté se déplace.
Ainsi en France, alors que les femmes représentaient un
tiers de la population active, elles en représentent près de la
moitié aujourd’hui, les taux d’emploi des femmes de 25 à 49 ans
étant passés de 40 % au début des années 1960 à 80 % aujour -
d’hui [5]. Alors que la famille typique des années 1950 et 1960
était constituée d’un couple marié avec trois enfants, aujourd’hui
un couple sur trois divorce en France (un sur deux en région
parisienne), et la fécondité est passée de 3 enfants par femme
à partir de 1946 et dans les années 1950, à 1,7 au milieu
des années 1990 pour remonter à 2 en 2007 [6]. Ce taux de
fécondité qui est aujourd’hui le plus élevé d’Europe ne suffit
cependant toujours pas à renouveler la population. En outre, le
ralentissement des années 1980 et 1990 réduit considérablement
la taille de la population active à venir, qui devra pourtant
financer un nombre de plus en plus grand de retraités [7], qui
vivent de plus en plus longtemps [8] et dont les besoins sociaux
s’accroissent (en matière de santé, mais surtout de prise en charge
de la dépendance [9]). Si les débats se focalisent en France sur les
nouveaux besoins engendrés par le vieillissement de la population,
on oublie cependant que la pauvreté s’est déplacée. Il y avait
7,1 millions de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté [10]
en France en 2005. Parmi eux, 6 millions ont moins de 60 ans,
dont 2 millions sont des enfants (moins de 18 ans) pauvres,
et 1,1 million ont entre 18 et 29 ans1. La pauvreté n’est plus
concentrée chez les personnes âgées, c’est aujourd’hui le problème
de femmes seules avec enfants, de personnes sans
diplômes, sans qualification, de chômeurs de longue durée.
Toutes ces personnes bénéficient de très peu de protection de la
part des systèmes traditionnels qui se sont concentrés sur les
retraites et la santé, autant de prestations qui bénéficient d’abord
aux plus âgés.
Les systèmes de protection sociale sont directement affectés
par les changements démographiques et familiaux : le vieillissement
de la population pose des problèmes de financement aux
systèmes de retraite, mais il a également un impact sur les questions
de la répartition du travail tout au long de la vie et de
l’adaptation des qualifications aux évolutions technologiques ; les
changements dans les relations familiales, l’augmentation du
nombre de familles monoparentales, de familles recomposées,
l’entrée massive des femmes sur le marché du travail perturbent
le fonctionnement de systèmes conçus sur un modèle familialiste,
où les droits sont accordés à celui (et rarement celle) qui a une
activité rémunérée et par extension aux membres de sa famille.
Les nouvelles formes de pauvreté sont mal prises en charge, et
encore moins évitées. Ces nouveaux défis poussent à repenser les
objectifs et les stratégies d’intervention des politiques sociales.
Tourner les politiques sociales vers le futur
Comment répondre aux nouveaux besoins sociaux ? En a-t-
on les moyens financiers ? Les politiques sociales pourraient-elles
contribuer à la nouvelle croissance économique ? L’heure
n’est plus au rafistolage des systèmes issus du passé mais à l’élaboration
de nouveaux principes et de nouvelles pistes. Les systèmes
européens de protection sociale sont bien trop différents pour
imaginer qu’un modèle social européen parfaitement unifié voie le
jour à brève échéance. En revanche, à partir d’une réflexion approfondie
sur les politiques sociales, mais aussi à partir des expériences
positives menées ici ou là en Europe (plus souvent dans les
pays nordiques qu’ailleurs), il est possible de souligner les réorientations
nécessaires pour permettre aux citoyens européens de vivre
dans les meilleures conditions possibles la transition d’une économie
essentiellement industrielle vers une économie de service,
qui mobilise des emplois de plus en plus qualifiés, mais fait aussi
appel aux services à la personne, souvent peu qualifiés.
De nouveaux risques de polarisation sociale apparaissent
avec la transformation des économies, et notamment avec le
développement d’emplois peu qualifiés et mal rémunérés. Pour
faire face à ces nouveaux risques, Gøsta Esping-Andersen propose
d’abandonner la perspective statique qui se contente de soulager
les difficultés présentes des individus ou bien de maintenir les
revenus perdus, pour adopter une perspective dynamique qui
pense les problèmes sociaux en termes de trajectoire de vie : quels
sont les investissements nécessaires aujourd’hui pour éviter
d’avoir à indemniser demain ? Comment éviter les effets cumulatifs
des handicaps sociaux tout au long de la vie [11] ? Il s’agit de
passer de politiques sociales réparatrices et compensatrices à une
stratégie préventive fondée sur une logique d’investissement
social. Dans cette perspective, ce sont les femmes et les enfants
d’abord qui devraient attirer notre attention, ne serait-ce que
parce qu’ils sont les seuls (les femmes encore inactives, les enfants
futurs actifs) susceptibles d’accroître les ressources à consacrer
aux retraites à venir. Ouvrir aux femmes le « deuxième âge de
l’émancipation » [12], permettre à tous d’acquérir les compétences nécessaires à l’économie de la connaissance, tels sont les nouveaux
défis pour l’État-providence, si l’on veut qu’il soit en outre
capable de financer les retraites ou les dépenses de santé à
l’avenir. Il s’agit en somme de préparer plutôt que de réparer, de
prévenir, de soutenir, d’armer les individus et non pas de laisser
fonctionner le marché, puis d’indemniser les perdants.
Pour ce faire, il faut inverser l’ordre des problèmes, redéfinir
le sens de la solidarité sociale, et compter autrement. Alors
même que nous avons du mal à financer des dépenses de santé
qui explosent, que les prévisions sont pessimistes pour les
dépenses de retraite, comment trouver de nouvelles ressources ?
C’est ici que Gøsta Esping-Andersen propose de penser autrement
certaines dépenses sociales : non pas comme un coût qui
entraverait la croissance économique, mais comme un investissement
qui accompagne et soutient la transition vers l’économie de
la connaissance. Aider les enfants à acquérir les compétences
adaptées aux activités de pointe, permettre aux femmes de travailler
: autant de garanties d’une croissance plus forte et de meilleurs
revenus pour l’État-providence. Les politiques sociales
peuvent retrouver une utilité économique, si elles sont conçues
non plus comme une dépense (un coût) qui intervient après la
croissance économique, mais comme un facteur de richesses
futures.
Pourquoi encore compter sur l’État ? Confier la protection
sociale au secteur et aux financements privés ne serait-il pas
moins coûteux et plus efficace ? Privatiser ne fera ni disparaître
les besoins, ni même baisser la facture. Il faudra de toute façon
couvrir les besoins des personnes âgées, besoins de revenus, de
santé, de prise en charge de la dépendance. L’investissement
social public paraît cependant plus efficace et plus juste que le
recours au marché ou aux familles. Notamment parce qu’il doit
permettre d’augmenter les chances de tous les enfants, de produire
en conséquence plus d’actifs bien occupés et protégés, et de
multiplier les emplois pour les femmes (le privé ne génère pas
tout seul des places en crèches accessibles à tous, les femmes les
plus démunies étant alors incitées à rester à la maison). L’investissement
social collectif peut en outre permettre de garantir une
plus grande égalité. Si l’on opte pour les dépenses privées, alors
les inégalités engendrées par le marché se reproduiront. C’est ici
que Gøsta Esping-Andersen rappelle les principes de justice
sociale qui doivent guider les nouveaux investissements sociaux :
celui de la garantie de l’égalité des chances pour tous les enfants,
celui de l’égalité pour les femmes (avec les hommes, mais aussi
entre les différents milieux sociaux), celui de l’égalité entre les
catégories de retraités, dont les revenus risquent de se polariser,
reflétant chez les retraités à venir les polarisations sociales présentes.
C’est au nom de l’égalité que cet ouvrage propose une
stratégie d’investissement public dans les politiques sociales pour
les enfants, les femmes et les personnes âgées. L’enjeu est de taille
pour la France, car les écarts de revenus comme les inégalités
générationnelles [13] y sont plus marqués que dans le Nord de
l’Europe ou aux Pays-Bas.
Les trois grands défis de l’État-providence au XXIe siècle
Le bouleversement social le plus important de ces dernières
décennies est sans doute celui qui a vu les femmes entrer massivement
sur le marché du travail. C’est pourquoi la première leçon
proposée ici est consacrée aux défis que représente pour l’État-providence
du XXIe siècle cette « révolution du rôle des femmes ».
Il est crucial de favoriser l’emploi des femmes et l’égalité entre les
femmes et les hommes par le développement des services sociaux de
prise en charge des enfants et d’autres personnes dépendantes.
Développer des crèches et d’autres services sociaux est une source de
créations d’emplois et permet aux mères de travailler. Cela apparaît
essentiel aussi bien pour les enfants que pour rendre compatibles
vie familiale et vie professionnelle. En outre, favoriser le travail des
femmes correspond à une volonté de ces dernières (acquérir une
autonomie financière par rapport aux hommes), mais aussi à un
triple besoin social : développer les services de prise en charge des
personnes dépendantes (jeunes et vieux), réduire les risques de pauvreté
des enfants (la pauvreté des enfants est toujours plus faible
dans les ménages où les deux parents travaillent) et augmenter les
taux généraux d’emploi (afin de dégager des ressources pour les
retraites). Mais des politiques favorables aux femmes ne peuvent se
satisfaire du seul objectif de compatibilité entre vie professionnelle
et vie familiale : elles doivent aussi insister sur l’égalité entre les
hommes et les femmes. Il s’agit bien sûr d’égalité de traitement
dans la vie professionnelle. Mais il convient également de rééquilibrer
la répartition des tâches domestiques. La vie professionnelle
des femmes, et notamment leurs carrières, adopte des traits de plus
en plus « masculins ». Une véritable politique d’égalité devrait
donc aussi viser à « féminiser » les traits de la vie des hommes, en
les incitant à s’investir davantage auprès des enfants et dans le foyer.
Garantir véritablement l’égalité des chances des enfants,
tel est l’objet de la deuxième leçon. Alors que les systèmes
actuels de protection sociale dépensent de plus en plus pour les
personnes âgées, il semble nécessaire d’investir dans les enfants.
Plutôt que de lutter contre l’exclusion sociale une fois qu’elle
est réalisée, plutôt que de devoir former de nouveau une maind’oeuvre
sur le tard, il vaut mieux concentrer les efforts sur une
démarche préventive centrée sur l’enfance. Lutter contre la pauvreté
des enfants et leur garantir les meilleures conditions de
garde et d’éveil doit à la fois permettre de prévenir l’exclusion (la
pauvreté sévit le plus chez les adultes issus de milieux pauvres) et
de préparer une main-d’oeuvre mieux formée, qualifiée et mobile
(une socialisation précoce en crèche permet de réduire considérablement
les risques de difficultés scolaires). Pour ce faire, il est
nécessaire à la fois de garantir un revenu minimal à toutes les
familles (donc de ne pas abandonner les anciennes politiques
distributives, voire de les développer : la lutte contre les effets
de la pauvreté et de la précarité des familles reste essentielle) et
de favoriser le développement des modes collectifs de prise en
charge des enfants qui garantissent une bonne socialisation primaire
et des conditions d’apprentissage de nature à préparer
convenablement l’avenir.
Si l’on parvient ainsi à augmenter les taux d’emploi
féminin et à garantir les meilleurs emplois aux futurs actifs, alors
des ressources plus importantes pourront être consacrées aux
retraites. La troisième leçon souligne que, dans le domaine des
retraites comme ailleurs, le souci d’égalité doit encore une fois
prévaloir, en maintenant l’équité entre générations mais aussi à
l’intérieur des générations. Pour maintenir l’équité intergénérationnelle,
les politiques de retraites proprement dites peuvent
appliquer le « principe de Musgrave », qui veut que, si l’on
modifie les niveaux de cotisations (payées par les actifs) ou bien
les niveaux des pensions des retraités, on le fasse en proportion
équivalente afin de ne pas modifier le rapport entre salaire net
des actifs et revenu net des retraités. Mais il convient aussi de
préparer les dispositifs publics à prendre en charge les disparités
de revenus à venir entre les retraités qui furent des actifs ayant
réussi à prendre le train de l’économie de la connaissance, et ceux
qui n’ont pu le faire.
On ne trouvera pas dans cet ouvrage des recettes passe-partout
qui seraient applicables du jour au lendemain. Cependant, le
mérite de ces orientations inspirées par certaines expériences et
réflexions européennes est de proposer un horizon nouveau et
commun pour les réformes de la protection sociale, qui ne se
limite plus à de simples restrictions budgétaires mais qui allie
adaptation aux nouveaux contextes économiques et progrès
social.
Gøsta Esping-Andersen, Trois leçons sur l’État-providence, La République des idées / Seuil, 2008, ISBN 978.2.02.097098.3, 11,5 €.
Traduit de l’anglais par Marianne Groulez.
Notes
[1] Voir Pierre Rosanvallon, La Crise de l’État-providence, Seuil, 1981, et les Trois
Leçons sur la société post-industrielle de Daniel Cohen, Seuil / La République des idées,
2006.
[2] Voir Robert Castel, Les Métamorphoses de la question sociale, Paris, Fayard,
1995 (édition de poche, Gallimard, « Folio / Essais », 1999).
[3] Gøsta Esping-Andersen, Les Trois Mondes de l’État-providence, Paris, PUF,
2007 (2e édition).
[4] Cf. Daniel Cohen, op. cit.
[5] Voir Margaret Maruani (dir.), Femmes, Genre et Société, Paris, La Découverte,
2005.
[6] Données INSEE.
[7] En France, les personnes de 65 ans et plus représentaient 16 % de la population
en 2000, ils représenteront 21 % en 2020, et 28 % en 2040.
[8] L’espérance de vie à la naissance était en 1950 de 63 ans pour les hommes et
de 69 ans pour les femmes, elle est aujourd’hui respectivement de 77 et 84 ans.
[9] Le risque de devenir dépendant est très élevé au-delà de 80 ans, le nombre
de personnes de plus de 80 ans dans la population française devrait passer de
2,2 millions en 2000 à 4 millions en 2020 et à près de 7 millions en 2040.
[10] Nombre de personnes vivant avec moins de 60% du salaire médian.
[11] Une enfance pauvre peut empêcher d’acquérir les compétences nécessaires
pour entrer plus tard dans une carrière professionnelle bien rémunérée et protégée,
processus qui peut entraîner des problèmes de précarité, lesquels déboucheront sur
de basses retraites.
[12] Pour reprendre le titre de l’ouvrage de Dominique Méda et Hélène Périvier,
Le Deuxième Âge de l’émancipation, Seuil / La République des idées, 2007.
[13] Voir notamment Louis Chauvel, Les Classes moyennes à la dérive, Seuil / La
République des idées, 2006.

 Mots-clés :
Mots-clés :