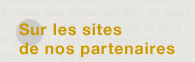Les illusions du 11 septembre
Y a-t-il un avant et un après 11 septembre comme on le prétend depuis maintenant un an ? Les attentats de New York et Washinton ont-ils véritablement ouvert un nouvel espace stratégique en même temps qu’ils mettaient fin au monde ancien ? Rien n’est moins sûr. Une analyse plus fine des relations entre les Etats-Unis et le monde islamique montre que beaucoup des évolutions qui ont surgi à la conscience collective ces derniers mois étaient déjà à l’œuvre avant le 11 septembre. L’événement a surtout permis de les reformuler dans un langage inédit - celui de la "guerre contre le terrorisme" et de l’"axe du mal" - , d’accélérer certaines décisions politiques et de pointer plus explicitement les enjeux et la complexité des relations entre Etats-Unis, Islam et Europe au seuil du nouveau siècle.
La plupart des analyses faites après le 11 septembre partent du principe qu’il s’agit d’un événement fondateur en termes de géostratégie, comparable par exemple à la chute de l’URSS. La métaphore de la « guerre » est ainsi utilisée pour la première fois afin de qualifier aussi bien un attentat terroriste que la réaction américaine qui l’a suivi. La nouveauté n’est évidemment pas dans le fait de la menace terroriste. Les Européens ont vécu avec elle depuis des décennies et n’y ont jamais vu un problème stratégique : la Grande-Bretagne a même réussi à gérer les campagnes de l’IRA (qui ont fait autant de victimes que l’attentat du World Trade Center) comme une sorte d’opération de police locale dont le déroulement n’a pratiquement jamais influencé les grandes options stratégiques et politiques du pays. Bien sûr les terrorismes irlandais ou basque ont toujours été limités dans leur dimension territoriale, mais les mouvements islamistes ou anti-impérialistes des années 1980 (Carlos ou l’Iran) ont aussi perpétré leurs actes dans un espace international.
La nouveauté n’est pas non plus dans le type de terrorisme. La véritable nouvelle menace terroriste, redoutée par les analystes, consisterait dans la privatisation d’armes de destruction massive (ADM), c’est-à-dire leur usage par des groupes non étatiques. Nombre d’auteurs ont déjà dénoncé le risque d’utilisation de telles armes par des réseaux terroristes privés et proposent aujourd’hui des formes de prévention et de ripostes qui sortent de la métaphore militaire [1]. Or le 11 septembre reste un attentat « classique ». Il a certes été commis par des kamikazes (qui, de surcroît, ont eu beaucoup de chance), mais les attentats de 1983 et de 1984 contre les Français et les Américains au Liban étaient aussi le fait de kamikazes. Enfin, le détournement simultané d’avions est une technique qui date des années 1970, et le World Trade Center avait déjà été la cible d’une tentative de dynamitage par Al-Qaida en février 1993. Ce qui fait apparaître le 11 septembre comme nouveau, c’est que d’un seul coup on visualise littéralement ce que pourrait être l’usage d’ADM par un groupe terroriste. Mais la nouveauté est dans la perception du danger, non dans sa mise en œuvre concrète.
La menace était de toute façon antérieure au 11 septembre : l’organisation Al-Qaida avait déjà annoncé, dans son communiqué de 1998, le déclenchement du jihad contre les intérêts américains dans le monde, ce qui avait déjà été le cas pour d’autres mouvements terroristes (dont Action directe ou le groupe grec du 17 novembre). Ce n’est donc pas la décision d’Al-Qaida de se positionner sur le plan mondial dans une guerre totale contre les États-Unis qui a amené ceux-ci à se déclarer en guerre. C’est l’attaque au cœur même du territoire, des institutions et des symboles américains qui constitue la nouveauté. Le 11 septembre est le premier acte de guerre étrangère commis sur le territoire américain depuis la campagne anglaise de 1812 ; il faut remonter à la guerre de Sécession pour voir autant de pertes en une seule journée. Le gouvernement américain a alors déclaré la « guerre contre le terrorisme » et en a fait le critère exclusif de toute sa politique étrangère : « Ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. »
Une deuxième dimension stratégique est ouverte par le débat sur les racines du 11 septembre. Avons-nous affaire à un nouveau spectre qui hanterait le monde occidental, celui du « terrorisme international », multiforme, aujourd’hui islamique, demain d’une autre nature, chaque fois mieux équipé, et qui, dans une stratégie d’apocalypse, ne viserait qu’à semer la mort et la destruction dans le monde des nantis en cherchant à s’emparer d’armes de destruction massive ? Ou bien s’agit-il au contraire d’une conséquence directe du conflit du Moyen-Orient, qui voit une jeunesse arabe, ulcérée par la politique américaine d’étranglement des peuples palestinien et irakien, se ranger sous la bannière de l’islam pour mener un combat désespéré ? Les enjeux du débat sont clairs : si le 11 septembre est une conséquence des crises du Moyen-Orient, alors il suffit de s’atteler à les résoudre et le terrorisme s’éteindra de lui-même. S’il s’agit d’un nouveau phénomène global et largement irrationnel, alors au contraire seule une politique de fermeté et d’intervention systématique peut le contrer. C’est cette seconde interprétation qui structure le discours officiel américain qui a suivi le 11 septembre : en reconnaissant que ce terrorisme n’est pas par nature étatique, même s’il peut recevoir le soutien d’un État hostile, Washington admet que l’on sort du champ stratégique classique, celui qui suppose que les acteurs, même dans l’asymétrie, luttent pour des enjeux qu’ils partagent (contrôle de zones d’influence, de richesses, de populations, d’instruments de légitimité, de jeux d’alliances). Cette invisibilité de l’adversaire permet plus aisément de repenser le conflit en termes moraux : le droit et la démocratie contre les forces obscures du mal. En revanche, l’opinion publique européenne est plus largement convaincue de la nature strictement moyen-orientale du terrorisme d’Al-Qaida, et donc de la nécessité de régler les deux grands conflits en suspens : la Palestine et l’Irak.
Les deux perspectives ne s’excluent évidemment pas : Al-Qaida peut à la fois être une conséquence des crises du Moyen-Orient et préfigurer une nouvelle forme de terrorisme. En refusant de l’analyser en termes moyen-orientaux, Washington a fait un choix : on peut s’attaquer au terrorisme sans s’interroger sur ses causes. Choix d’autant plus facile que les États-Unis, principalement pour des raisons de politique intérieure, refusent de mettre en cause leurs choix antérieurs qui auraient conduit à la crise : soutien quasi inconditionnel à Israël et volonté d’en finir avec Saddam Hussein.
Mais la critique d’une position aussi intransigeante bute aussi sur un écueil : qu’y a-t-il à négocier ? Une solution du conflit israëlo-palestinien tarira-t-elle le terrorisme d’origine islamique ? Rien n’est moins sûr. Le vrai problème n’est pas de savoir s’il faut négocier avec le terrorisme, mais s’il y a un espace de négociation. Bien des mouvements aujourd’hui honorables ont commencé comme mouvements terroristes ou y ont été contraints : l’IRA irlandaise, l’Irgoun à l’origine du Likoud, le Hezbollah libanais, l’OLP palestinienne, les Tigres Tamouls sont des organisations qui ont eu recours au terrorisme et avec qui on a pourtant négocié, ou qui, une fois leurs objectifs atteints, sont devenues des interlocuteurs. Si la France a discuté avec l’Iran et le Hezbollah en 1986 pour la libération des otages, ce n’est pas par lâcheté, mais bien parce qu’il y avait quelque chose à négocier.
Savoir s’il y a un terrorisme légitime est un faux débat (car ce débat est toujours conduit soit du point de vue du vainqueur, soit à partir d’une discussion sur les valeurs, construite après coup et qui oublie que la négociation se fait pour obtenir la paix, plus souvent que la justice [2]). Il faut en revanche distinguer entre un terrorisme inscrit dans un espace politique qui permet la négociation et un terrorisme de rupture. Ce que l’on reproche aujourd’hui à l’ETA basque est moins d’être une organisation terroriste que de ne pas avoir suivi le modèle de l’IRA, c’est-à-dire celui de la négociation ; ce que l’on demande à l’ETA, c’est de mettre fin à la guerre et de négocier son passage au parlementarisme, ce n’est pas de se livrer à la justice (ce qui ne sera possible qu’en cas de sévère défaite). En ce sens, les réticences américaines devant la création de la CPI sont aussi à lire comme le refus de l’impossible judiciarisation du champ politique (mais les États-Unis seraient, il est vrai, plus crédibles s’ils acceptaient d’appliquer leur propre droit aux prisonniers de Guantanamo).
La question est bien de savoir s’il existe un espace de négociation, non pas tant avec Al-Qaida comme organisation qu’avec ceux qui peuvent y projeter leurs frustrations, leurs attentes et leur soif de revanche. Il y a donc bien un enjeu fondamental dans le débat sur la dimension moyen-orientale du terrorisme ou bien sur la nature quasiment métaphysique de la menace. Notre thèse, très minoritaire, est que les racines d’Al-Qaida ne sont ni dans l’islam en soi, ni dans le conflit actuel du Moyen-Orient (même si bien sûr ces deux dimensions surdéterminent et le discours tenu par Al-Qaida et l’interprétation que l’on fait du mouvement), mais qu’elles ne relèvent pas non plus d’un modèle métaphysique et abstrait du nouveau mal. Al-Qaida est à la jonction d’une radicalisation islamique et d’une contestation anti-impérialiste exacerbée, délocalisée par la globalisation, c’est-à-dire décalée par rapport au Moyen-Orient et à ses conflits. Mais notre objet ici n’est pas l’analyse d’Al-Qaida [3], mais la manière dont la réaction américaine au 11 septembre restructure (ou non) un espace stratégique, dont nous ne savons si nous y figurons au titre de spectateurs, d’alliés, d’otages ou de complices. Revenons donc à une analyse plus terre à terre. Peut-on effectivement élaborer une stratégie envers l’islam ou bien la question est-elle hors sujet, du fait de l’hétérogénéité des phénomènes que l’on met sous l’étiquette islamique ?
Notes
[1] Thérèse Delpech, Politique du chaos. L’autre face de la mondialisation, Paris, La République des Idées/Le Seuil, 2002.
[2] L’aporie sur les guerres justes bute toujours sur la question de l’amnistie : l’amnistie est juste politiquement, mais injuste moralement. La grandeur des dirigeants du Sin Fein est d’avoir mis l’IRA sur la voie de la paix, quel qu’ait pu être leur passé personnel.
[3] Nous développons ce point dans un autre livre : Olivier Roy, l’Islam mondialisé, Paris, Le Seuil, 2002.

 Mots-clés :
Mots-clés :