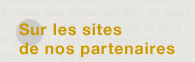La fatigue des élites
Les cadres passent pour les « compétitifs » de l’économie moderne, ceux à qui le capitalisme promet l’accomplissement et la réalisation de soi. Pourtant, ces hommes et ces femmes dont l’entreprise attend dévouement et solidarité, donnent aujourd’hui le sentiment de ne plus y croire. Ils ne s’identifient plus aussi facilement au destin de leur société, cherchent à se dérober aux pressions de leur environnement, voire adhèrent aux critiques les plus frontales du nouvel ordre économique. Bref, ils commencent à « jouer contre », eux dont on croyait qu’ils joueraient toujours « avec ». Le spectre d’une « révolte des cadres », hier encore inimaginable, entre peu à peu dans l’ordre du pensable. On se prend à imaginer que le désordre social ne surgisse pas d’une mobilisation des « petits » contre le capitalisme, mais du cœur même de ses élites. Ce serait là le tribut paradoxal d’une révolution des organisations qui, en consacrant la domination de l’actionnaire et du client, a progressivement privé d’autonomie et de protection ceux-là mêmes dont elle prétendait faire ses messagers auprès des autres salariés.
Introduction
Les cadres passent pour les « compétitifs » de l’économie moderne, ceux à qui le capitalisme semble promettre l’accomplissement, la réalisation de soi et le bonheur personnel. Pourtant, ces hommes et ces femmes dont l’entreprise attend dévouement, allégeance et solidarité, donnent aujourd’hui le sentiment de ne plus y croire.
Depuis plus de dix ans, l’auteur de ces pages a enseigné dans les business schools européennes et nord-américaines à quelque 30 000 cadres de tous pays, de tous secteurs et de tous niveaux. Les leçons de ce périple sont sans appel : les cadres vivent de plus en plus difficilement leurs situations quotidiennes au travail, ne s’identifient plus aussi facilement au destin de leur firme, cherchent à se dérober aux pressions croissantes de leur environnement, voire adhèrent aux critiques les plus frontales du nouvel ordre économique qu’ils ont vu se mettre en place dans les années 1990 et dont le client et l’actionnaire tiennent le haut bout. Bref, ils commencent à « jouer contre », eux dont on croyait jusque-là qu’ils joueraient toujours « avec ».
Tant et si bien que le spectre d’une « révolte des cadres », hier encore inimaginable, entre peu à peu dans l’ordre du pensable. Certes pas dans les formes traditionnelles du mouvement ouvrier, mais sur un mode plus individualiste : stratégies de fuite et de désinvestissement, multiplication des comportements de résistance passive et active, bricolages en tous genres destinés à recréer localement les conditions d’un minimum de confort personnel au travail. On se prend à imaginer que le désordre social ne surgisse pas à l’avenir d’une mobilisation des « petits » contre le capitalisme, mais de ses propres gardiens et messagers. La maladie à laquelle l’entreprise devrait alors faire face se développerait au cœur même de ses élites. Ce scénario relève encore de la science-fiction sociologique, mais un faisceau d’indices récurrents suggère que nous pourrions en prendre le chemin.
L’idée du « malaise des cadres » n’a, en soi, rien de très nouveau. L’expression est apparue au moment précis où les cadres obtenaient leur reconnaissance bureaucratique par la création d’une caisse de retraite spécifique : c’est en 1947 qu’elle est utilisée pour la première fois, au moins dans la presse professionnelle, en même temps qu’est créée l’Agirc (Association générale des institutions de retraite des cadres). Cette coïncidence souligne un fait simple : il y a chez les cadres un « mal-être » quasi inhérent à leur existence et à leur position dans les organisations. Celle-ci est en effet caractérisée par une ambiguïté congénitale : à la fois salariés comme les autres et différents des autres, en ce qu’ils représentent les « propriétaires » et leurs intérêts, qu’ils sont justement en charge de faire respecter par ceux qu’ils « encadrent ». « L’exercice de l’autorité » leur est d’ailleurs toujours apparu comme la composante la plus délicate de leur fonction. Dans une enquête inédite menée en 1974, 56 % d’entre eux trouvaient « l’exercice de l’autorité plus difficile qu’autrefois ». À l’époque, ils liaient cette difficulté à un affaissement de la considération dont ils faisaient l’objet, à une « crise de société temporaire » ou encore à l’importance accordée aux organisations syndicales qu’ils accusaient de contester leur position d’intermédiaires obligés entre les directions et les salariés.
Cette notion de malaise est donc trop générale et récurrente pour rendre compte de ce qui a changé, ces trente dernières années, dans les perceptions et les pratiques des cadres. Les perceptions, car il s’agit de mesurer l’appréhension qu’ils ont ou n’ont pas de la détérioration de leur situation ; les pratiques, car il s’agit aussi de saisir les conséquences concrètes qu’ils en tirent en termes d’investissement dans le travail et d’attachement à l’entreprise.
L’enquête de 1974 permet pourtant d’anticiper quelques évolutions ultérieures. À la fin des Trente Glorieuses, le sentiment qui dominait chez les cadres était celui d’un optimisme raisonné. Ils avaient à la fois un métier intéressant et des responsabilités. Ils aspiraient à être toujours davantage partie prenante de la direction de leur entreprise. Ils témoignaient d’une grande confiance dans l’organisation pour laquelle ils travaillaient. Lorsqu’inquiétude il y avait, elle était rabattue sur des phénomènes très généraux, tels que « la crise de la civilisation industrielle ». Quant à l’avenir, il apparaissait souriant. Ils percevaient leur rôle comme s’étant détérioré « dans les dernières années », mais comme devant « changer positivement » dans les domaines les plus intimement liés à leur identité : ils étaient 77 % à s’imaginer « avec un métier plus intéressant dans 5 à 10 ans », 79 % à anticiper « une meilleure situation pécuniaire » et 71 % à se prédire « un meilleur statut ». En outre, ils faisaient confiance aux « méthodes modernes de management » et ne croyaient guère à l’efficacité ni aux vertus de l’action collective.
En d’autres termes, les facteurs de pessimisme étaient apparemment exogènes et faisaient écho à des stéréotypes généralisateurs qui traduisaient leur désarroi devant des évolutions encore naissantes, mais sans doute porteuses de troubles pour eux. Ils pensaient ainsi que les formes traditionnelles de l’autorité allaient se désintégrer, qu’il fallait s’attendre à une longue période de difficultés économiques, qu’une transformation politique et sociale était inévitable et qu’elle obligerait à modifier les structures de l’entreprise.
Rétrospectivement, cette juxtaposition d’attitudes traditionnellement conformistes et d’une vision pessimiste de l’évolution sociale générale laisse penser qu’ils avaient confusément l’intuition de ce qui se préparait et qu’ils cherchaient à en conjurer les signes annonciateurs. Comme toujours lorsqu’il s’agit d’exprimer un problème sans vouloir s’en afficher directement victime, le propos négatif était formulé en termes généraux, alors que s’exprimait un optimisme de bon ton en ce qui concernait l’évaluation de leur propre devenir. Mais cette rhétorique dissimulait un doute naissant qui, lorsqu’il se concrétiserait, irait bien au-delà d’un simple « malaise ». Chez ces cadres du milieu des années 1970, les changements dans le monde du travail et dans la société en général commençaient à heurter la confiance qu’ils avaient jadis placée dans la solidité des entreprises et la stabilité des rapports sociaux. Derrière les généralités contradictoires à travers lesquelles ils exprimaient leurs inquiétudes, se profilaient déjà les changements d’organisation qui viendraient bouleverser leurs conditions de travail et remettre en cause une situation somme toute privilégiée. Car ce sont bien ces changements d’organisation qui expliquent le désarroi actuel des cadres.
Pour le comprendre, il faut repartir des transformations qui ont affecté l’organisation du travail ces dernières décennies. On convient volontiers aujourd’hui que le travail se détériore. Mais, au-delà des seules conditions de travail - l’ergonomie, la dangerosité, la pénibilité... -, ce sont les conditions du travail qui empirent. C’est-à-dire à la fois les protections traditionnelles acquises ou conquises par les salariés (celles que Robert Castel appelle les protections sociales), et les relations qui unissent les hommes entre eux dans le travail, les situations d’autonomie ou de dépendance, les « confrontations » et la façon de les réguler. Or, contrairement aux apparences, le mouvement actuel de réduction des protections liées au travail ne concerne pas seulement les protections sociales : il s’attaque aussi en profondeur à celles que produisaient sans le dire les anciennes formes d’organisation.
En effet, les façons de travailler dans des univers segmentés, séquentiels, clairs, issus du taylorisme bureaucratique, apportaient à ceux qui en bénéficiaient de solides contre-feux à la pression de l’environnement, celle des collègues ou des clients. En parcellisant le travail, la logique taylorienne avait résolu le problème de la dépendance et de l’exposition directe aux autres, à leurs demandes, à leurs exigences, à leurs impatiences.
Il n’en va plus de même aujourd’hui. Les « autres » sont bel et bien de retour : le client, cette idole du management moderne, est une contrainte permanente pour les organisations et leurs membres ; et les collègues avec lesquels il faut désormais « faire équipe » et « coopérer », une source inépuisable de stress et de pression. C’est cette double confrontation que les organisations modernes imposent à leurs membres avec leurs « structures matricielles », leurs « fonctionnements en projets » ou leur impératif de coopération. Et ce sont les cadres, ce « salariat de confiance », qui sont aux avant-postes de ce processus de « déprotection ».
Les cadres restent certes mieux protégés que les autres salariés face à la question endémique de l’emploi : leur taux de chômage est trois fois inférieur à la moyenne nationale. Cependant, même dans ce domaine, les chiffres montrent que leur « risque de perte d’emploi » augmente, et ce au même rythme que pour les ouvriers et les employés depuis le début des années 1990. S’ils « rebondissent » mieux que d’autres, du fait de leur formation, les cadres font de moins en moins exception aux difficultés qui affectent l’ensemble du salariat. Cette évolution est encore plus nette dans d’autres domaines. Eu égard à leur situation générale dans les entreprises, à la façon dont ils sont traités - évalués, promus, déplacés, etc. -, à leur degré de proximité avec leur direction générale, leur situation et leur identité n’ont cessé de se rapprocher de celles des autres salariés. Bref, dans le temps même où ils se « massifiaient » (ils représentent près de 15 % de la population active aujourd’hui, contre 4,7 % en 1962 et 10,7 % en 19907), les cadres se sont banalisés. Pire : si l’on excepte les questions du chômage et de la pénibilité physique pour se concentrer sur les autres formes de « souffrance » générées par le travail, ils semblent avoir « décroché ». Ces autres formes de souffrance ne renvoient pas seulement à la particulière sensibilité de ceux qui les endurent (un « problème de riches », diraient certains) : elles posent question aux organisations elles-mêmes qui voient peu à peu s’éloigner d’elles cette partie de la population qu’elles continuent par ailleurs à revendiquer comme essentielle.
Deux éléments se conjuguent pour aggraver cette situation. D’une part, l’individualisme traditionnel des cadres qui est quasi consubstantiel à leur existence. Ce qui les fait exister en tant que tels, c’est leur talent individuel, leur particularité, leur « valeur ajoutée personnelle ». Cela justifie aujourd’hui encore le fait de tout miser sur l’action individuelle dès lors qu’il s’agit de gérer sa carrière ou plus généralement d’améliorer sa condition. C’est là une différence notable avec les autres salariés qui ont rapidement compris la dimension éminemment collective de leur condition. Dès lors, au moment où la déprotection les frappe de plein fouet, les cadres ne démontrent que peu de capacités à élaborer une réponse collective : ils acceptent de facto leur « vulnérabilité individuelle de masse ». Ce qui fut jusqu’ici leur trait distinctif se retourne contre eux.
D’autre part, les organisations ont profondément changé depuis le milieu des années 1970. Ce ne sont pas tant les structures qui se sont modifiées, que les façons quotidiennes de travailler qui s’imposent à leurs membres. Cette évolution doit se comprendre comme un renversement radical de la finalité implicite de l’existence de l’entreprise : jusqu’à la fin des Trente Glorieuses, il était admis, dans les modes de fonctionnement au jour le jour, que les entreprises travaillaient avant tout pour ceux qui y travaillaient ; clients et/ou actionnaires passaient après. Ce caractère endogène tenait à un contexte économique qui donnait le pouvoir à ceux qui produisaient ou fournissaient, et non à ceux qui achetaient. Les premiers pouvaient ainsi définir leurs modalités de travail en fonction de leurs besoins et de leurs contraintes propres, et non de leur environnement. Depuis trente ans, cette logique se renverse et les cadres qui en avaient été les principaux bénéficiaires se retrouvent parmi les premières victimes de la situation nouvelle.
Que s’est-il passé ? La mondialisation a eu pour effet d’inverser la relation de pouvoir entre les fournisseurs et leurs clients. Nous sommes passés d’une période où les produits (biens ou services) étaient rares, à une période où ce sont les clients qui le sont. Cette inversion de la rareté n’a pas seulement fait chuter les prix et condamné ceux qui peinaient à s’adapter. Elle s’est traduite par une véritable domination des clients et derrière eux des actionnaires, et par des demandes toujours croissantes en termes de qualité du produit fourni et de réduction des coûts.
Cette double « demande » n’a pu être satisfaite qu’en changeant profondément les façons de travailler, c’est-à-dire les organisations au sens le plus concret du terme. Car il est bien vite apparu que la segmentation séquentielle des organisations traditionnelles était génératrice de surcoûts et de faibles niveaux de qualité.
Mais dès lors qu’il s’agit de travailler autrement, de substituer la simultanéité au séquencement, le flou des structures à la clarté de la division du travail, la coopération immédiate à la transmission bureaucratique des dossiers, les protections liées aux formes antérieures de travail volent en éclats. Chacun devient responsable et comptable du tout au-delà de la partie dont il a la charge ; le client « remonte » dans l’organisation et, poussé par l’actionnaire, impose ses exigences de coût et de qualité à chaque niveau de la « chaîne de valeur ». L’exposition aux autres, à leurs logiques contradictoires, devient la règle pour tous. Alors que les dérives de coût et de qualité pouvaient jadis être externalisées vers un client qui était bien obligé de les accepter, elles sont à présent réinternalisées au prix d’une pression croissante qui brise définitivement les conforts antérieurs.
Les cadres se retrouvent surexposés à des tensions diverses et contradictoires qu’ils doivent à la fois subir et approuver, puisqu’ils sont, dans l’entreprise, ceux qui sont censés comprendre les impératifs du marché et à l’occasion les expliquer aux autres ! À leur autonomie antérieure, la vraie, celle que l’on se construit pour soi, se substitue une individualisation extrême de l’évaluation de la performance et des modes de rémunération, qui va parfois jusqu’à les « sortir » du salariat, c’est-à-dire la première des protections, celle liée à l’affiliation. On perçoit l’ampleur du bouleversement pour une population qui, il n’y a pas si longtemps, se vivait comme la grande bénéficiaire de la modernité.
Cette situation engendre deux séries de conséquences. Celles-ci sont microsociales d’abord, dans les tentatives individuelles et dispersées des cadres pour se recréer des zones de paix individuelle, des espaces de non-dépendance et de non-confrontation. Les cadres utilisent pour cela toutes les contradictions des organisations modernes qui veulent à la fois évaluer chacun sur sa performance personnelle à court terme, et pousser tout le monde à coopérer. Nous verrons comment l’absence de cohérence entre les systèmes de gestion des ressources humaines et ce que l’on attend des cadres, leur ouvrent des zones de liberté dans lesquelles ils s’engouffrent à la première occasion. Aux grandes bureaucraties traditionnelles, ils substituent désormais des bureaucraties locales et clandestines, génératrices du minimum de confort nécessaire pour faire face à un environnement de plus en plus exigeant et hostile.
Les conséquences sont aussi macrosociales. La grande entreprise cesse à son tour d’être un lieu d’intégration. Comme la plupart des grandes institutions autour desquelles s’est structurée la vie sociale pendant des décennies, elle disparaît peu à peu du champ du possible pour qui cherche une collectivité protectrice et porteuse de repères. Non seulement on y utilise de plus en plus des mots et des slogans qui n’ont guère de sens concret pour ceux à qui ils sont destinés, mais encore on y offre de moins en moins de possibilités de se réaliser par le simple fruit d’un travail normal et équilibré. Voila sans doute une évolution qui apporte sa pierre au rejet des « nouveaux entrants » vers des communautés de base différentes de celles qui se constituaient traditionnellement autour du travail. C’est une nouveauté, et il n’est pas sûr qu’elle soit positive.
Peut-on entrevoir une issue à cette situation ? J’évoquerai quelques pistes à la fin de cet essai. Mais il faut être bien conscient que rien ne se fera tant que les dirigeants ne prendront pas plus de précautions et de recul par rapport aux rhétoriques et aux pratiques managériales ambiantes et inflationnistes. C’est à une véritable surenchère verbale et instrumentale que les cadres sont aujourd’hui confrontés. En la matière, l’aphorisme de Michel Crozier - « personne ne commande mais tout le monde obéit » - n’a jamais été aussi vrai. Un tel retour à la réalité du possible, à la prise en compte de ce que sont les hommes dans leurs capacités à faire mais aussi à résister, bref de leur intelligence, ne se produit jamais spontanément. Il est le résultat d’une situation de crise, d’un changement plus ou moins brutal du contexte qui amène les acteurs (en l’occurrence, les dirigeants) à réviser leurs stratégies.

 Mots-clés :
Mots-clés :